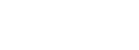"E fuor le pecorelle…"
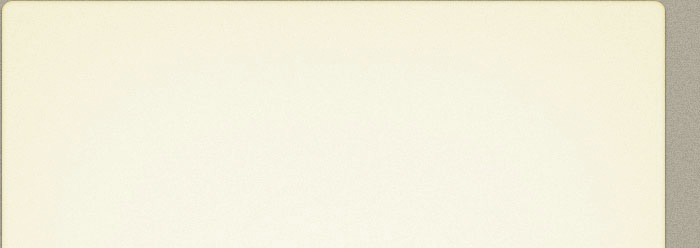

Feraghjettu cortu e maladettu é un castigu pè a ghjente e per l’enimali. I ghjorni allunganu, l’inguernu n’ha più per pocu, ma tene sempre tasta. A sanu i pecurai: e pecure pascenu l’erba di i prati à capu in pianu e temenu a neve.
Toccu feraghju, discidendusi a mane, u pecuraiu é inchjetu: "chi tempu ferà?". Simu à l’albore. Ci si vede à schersu. U pecuraiu s’arrizza e apre a porta. Un ventu ghjalatu s’infrungna in casa. Ellu appinza l’ochji e feghja. A campagna é bianca. Serà una ghjornata pessima. Ci vorrà à tene e pecure chjuse. E u fenu cummencia à mancà… U pecuraiu si scalla un caffè e aspetta. Va da un capu a l’altru di a sala incù a tazza di caffè in manu, lagnendusi, forse ancu ghjurendu; e riflettendu à ciò chi si porrà fa.
Ma u sole spunta. I so primi raggi entrenu pè u portellu e mettenu appena d’alegria in la stanza. U pecuraiu spalanca a porta. U sole cambia tuttu. Ciò chi parìa neve unn era che ghjelu. Bastava à pazientà. U pecuraiu unn ha più l’eria disperata d’un’oretta fa. Ride e a si fischjuleghja. Eppò piglia a so saraca, a so beretta, u so bastone e esce di casa. E s’appronta à caccià fora e pecure, per falle pasce.
A miò manera di contavvi i penseri di u pecuraiu, arrittu à l’alba una mane di feraghju, a troverete forse appena sgalabata e averete ragiò… Quantu seremu, noialtri corsi, ad avè avutu un babbone o un’antibabbone pecuraiu? Per falli onore eccu à ciò c’o ne vulìa ghjunghje: ssi penseri l’ha conti Dante settecent'anni fa. Ecculi i bellissimi versi di u gran poeta:
In quella parte del giovanetto anno,
Che’l sole i crin sotto l’Aquario tempra,
E già le notti a mezzo dì s’en vanno.
Quando la brina in su la terra assempra
L’imagine di sua sorella bianca,
Ma poco dura alla sua penna tempra;
Lo villanello a cui la roba manca,
Si leva e guarda, e vede la campagna
Biancheggiar tutta, ond’ei si batte l’anca;
Ritorna in casa, e qua e là si lagna,
Come ‘l tapin che non sa che si faccia,
Poi riede, e la speranza ringavagna,
Vegggendo il mondo aver cangiata faccia
In poco d’ora; e prende suo vincastro,
e fuor le pecorelle a pascer caccia.
E cusì mi scuserete pè u miò introitu.
"E fuor le pecorelle…"
Février, court et maudit, est une sorte de damnation pour les troupeaux de brebis et pour leur bergers. Certes, les jours rallongent, l'hiver a accompli plus de la moitié de son temps, mais il ne faiblit pas. Or les brebis paissent, tête basse, l'herbe des champs.
Dès son réveil, le berger est inquiet: "Quel temps fera-t-il aujourd'hui?" Nous sommes aux premières lueurs de l'aube; on y voit à peine. Le berger se lève, il ouvre sa porte. Un vent glacé envahi la demeure. Lui, voit la campagne toute blanche; ce sera une mauvaise journée. Il faudra garder les bêtes enfermées et le foin commence à manquer… Le berger se fait chauffer un bol de café; il va d'un coin à l'autre de la pièce, son bol à la main, ne sachant trop quoi faire.
Voici enfin le soleil! Ses premiers rayons apportent un peu de joie dans la pièce. Le berger ouvre grande sa porte. Avec le soleil tout change: ce qui paraissait de la neige n'était que du givre. Il suffisait de patienter un peu. Le berger n'a plus l'air désespéré. Il rit, il sifflote… Il prend veste, casquette bâton et sort de la maison. Rassuré, il s'apprête à faire sortir ses brebis, pour qu'elles aillent paître.
Ma manière de vous conter les soucis du berger, debout à l'aube un matin de frévrier, vous la trouverez peut-être gauche et vous n'aurez sans doute pas tort… Combien serons-nous, nous autres Corses, à avoir eu un père ou un grand père berger? Pour leur faire honneur, voici où je voulais en venir: leurs soucis, Dante les a évoqués il y a sept cents ans dans sa "Divine Comédie". Les voici, pour vous lecteur, les très beaux vers du grand poète:
En cette époque de l'année toute jeune
Où le soleil trempe ses cheveux dans le Verseau,
Et les nuits sont déjà la moitié du jour,
Quand le givre transcrit sur la terre
L'image de sa très blanche sœur,
Mais la teinte dure peu à sa plume,
Le villageois qui n'a plus de fourrage
Se lève et regarde, et voit la campagne
Toute blanche; alors il bat ses flancs
Rentre dans sa maison, ça et là se lamente
Comme un pauvret qui ne sait que faire;
Puis il ressort, et l'espoir vient dans son panier
Quand il voit que le monde a changé de visage
En quelques heures, et il prend son bâton
Pour mener ses brebis au pâturage.
(Traduction, Jacqueline Risset)
-> Retour à la liste des textes