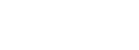I ‘mpiastri di Zià Maria-Stella


In quellu paisucciu cusì tranquillu à Zia Maria-Stella ùn si sentìa mai. Era una dunnuccia gentile e alegra, sempre affaccendata e sempre pronta à aiutà a vicinanza. E listessa cosa quand’ella era in pieghja incù u maritu, l’inguernu, in tempu di zappere e di potere. Dicìà chi in duv’ellu ne manghjava dui ne manghjava trè. E, s’elli eranu di più, chi ci vulìa à sperte un lonzo e à fà frighje cinque o sei ove, à tombà un ghjallochju o à arruste un figatellu e fà dui pomi fritti ? D’avè ghjente à tavulinu, di Zia Maria-Stella eranu i so sciali.
In più di a so gentilezza, ciò ch’ella avìa, quella vechjuccia, era a passione di a pulitica o, per di megliu, di l’elezioni. E quand’elle venìanu l’elezioni, Zia Maria-Stella unn era più ella. Ùn pensava à nunda d’altru; si lesciava ancu e so faccende. Era ancu più brava incù i soi, quessa è bella che capita. A casa era sempre piena; c’era sempre ghjente chi manghjava; era festa ancu pe i cani di u vicinatu chi si rudìanu i schinchi di i prisuti. Ma incù i contarii, diventava arrabbiata. Ella chi stava sempre in lu so cantu, in tempu d’elezioni, girava u paese à sustene un’ per unu l’elettori di u maritu, à circà d’attirassi i manganati e ancu à stassi à e scurtichje, pietta di notte in un portò o sott’à un fornu, per sente ciò ch’elli cunfabulavanu i contrappertitu. Era più accanita ella che l’omi di a famiglia. S’elli vincìanu, da a gioia era cume scema. Dicìa: “U cunfalone e u stampone l’avimu noi, ch’ella piecqui o nò ci vorrà à stacci”.
Ma unn era solu pe a merrìa ch’ella s’arrabbiava, Zia Maria-Stella; era listessa pe u cunsigliu generale. Un annu, e cosi fubbenu veratimente intrisicate. U dottore era votu à votu incù u notaru e, in più, da u cantone dipendìa a presidenza di u cunsigliu generale. Ssa volta i capizzoni gironu paese per paese. Ghjunsenu tutti, da Aiacciu e da Parigi. Infuriata cume quell’annu, à Zia Maria-Stella nimu l’avìa mai vista. Ella, incù u maritu, era pe u notaru. Girò incun’ellu e incù i capizzoni in paese e fora à paese. Unn arriposava nè ghjornu, nè notte.
A sera di l’elezioni, fattu u scrutinu, tempu ch’ella ha sapiutu ch’ellu avìa vintu u notaru, pertì à pedi, incù u maritu e tutti i so partigiani à fà l’eviva e ghjunse di notte à u capilocu. Ella era in testa; portava u drapeau di a merrìa. Cuntenta e tant’arrabbiata cume ella era quella notte stridò forse più “abbassu u dottore” che “eviva u notaru”. Ma a gioia ùn si controlla. “Ch’ella piecqui o nò, ci vorrà à stacci!” Cusì dicìa Zia Maria-Stella sventulendu u drapeau per tutti i chjassi di u capilocu...
Eppoi, passate l’elezioni, rivenne a vita di sempre. Quelle di e faccende e di a gentilezza e di l’aiuta in tra di vicinenti e di paisani; quella di e gierdine, di l’ottobre in li castagneti e di l’inguernu in le vigne di pieghja. A vita ch’ell’avìa sempre fattu, Zia Maria-Stella. E una sera, à mezu ferraghju, quella vechjuccia ghjunse da pieghja infrebata. Acciaccata in lu lettu incù dui cuvertoghji addossu era inturniata da una quindecina di e so paisane chi stavanu zitte pronte à succorela à u minimu lagnu. Ma a malata ùn si lagnava. Avìa dettu di chjamà u dottore, quellu chi avìa persu l’elezioni, aghjustendu ch’ella unn avìa fede che in quellu...
L’aspettava u so dottore Zia Maria-Stella! E quellu ghjunse dopu duie orette. A sondò, disse, fora di camera, à u maritu e à nora ch’ell’avìa una puntura e ch’ellu li ci vulìa teghje calle, ventose, impiastri e dieta.
A malata volse sapè anch’ella ciò chi u dottore dicìa à a so ghjente...
- “Dicu chi vo’ avite chjappu un rifreddore, ô Zia Marì!
- Allora chi ci vole à fammi, ô sgiò dottore?
- Impiastri di drapeau ô Zia Marì! E v’avite da sente subitu megliu.”
Les cataplasmes de Zia Maria-Stella
Zia Maria-Stella vivait dans un petit village tranquille et le plus souvent elle ne s'y faisait pas remarquer. Elle était aimable et gaie, toujours occupée, toujours prête à donner un coup de main aux voisins, aussi bien au village qu'à la plaine où elle accompagnait son mari, l'hiver, lorsqu'il fallait piocher la vigne ou la tailler. Chez elle, c'était table ouverte. Elle était ravie d'avoir du monde chez elle autour d'un bon repas. Elle disait que, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Si on était nombreux, on pouvait toujours entamer un “lonzu”, faire frire des œufs, tuer un poulet, ou même griller un “figatellu” et l'accompagner de pommes de terre. Pas de quoi en faire une montagne!
Cette si gentille petite vieille avait une véritable passion pour la politique ou, plutôt, pour les élections. En période électorale, on ne la reconnaissait plus. Elle en venait même à négliger son travail. Avec ceux de son parti, elle était plus gentille encore que d'habitude. Sa maison ne désemplissait pas, il y avait tout le temps des amis en train de casser la croûte. Même pour les chiens, c'était bombance, ils ne manquaient pas d'os de jambon à ronger.
Avec les adversaires politiques, elle était nettement moins aimable. Alors que d'habitude, elle ne quittait pas son quartier, en période d'élections, elle vadrouillait partout, afin de maintenir vivace la pugnacité des électeurs de son mari, (qui, vous l'aurez compris, était le maire du village) et magouillait pour attirer ceux qui pourraient se laisser acheter. Il lui arriva, certains soirs, de passer le seuil de certaines maisons, de se cacher au bas de l'escalier voire même sous le four à pain, pour essayer de surprendre les conversations et les coups tordus de ses ennemis. Elle était plus active que les hommes de la famille, c'est tout dire. Si son parti emportait les élections, elle devenait hystérique, répétant à qui voulait l'entendre: “Le drapeau et le tampon sont à nous, que cela leur plaise ou non, ils devront le supporter”.
Ce n'étaient pas seulement les élections municipales qui l'excitaient, Zia Maria-Stella, il y avait aussi les cantonales. Une fois, cela s'annonça mal. On avait beau compter et recompter les voix, il semblait que le médecin en aurait autant que le notaire. L'élection du président du conseil général dépendait de la couleur politique de ce canton-là. Chaque clan s'y intéressait de près. Les candidats, dans cette situation, payèrent de leur personne; on vit les notables serrer des mains dans le moindre petit village. Chaque camp fit venir ses électeurs de partout, d'Ajaccio comme de Paris. On n'avait jamais vu Zia Maria-Stella aussi enragée. Jour et nuit, on la trouvait aux avant-postes. Elle et son mari étaient pour le notaire, et ils l'accompagnèrent de village en village.
Ils gagnèrent. Dès qu'elle l'apprit, Zia Maria-Stella se mit en route, à pied, avec son mari et tous leurs partisans, pour aller festoyer au chef-lieu du canton. Elle marchait en tête, portant le drapeau de la mairie. Cette nuit-là, elle cria plus souvent: “A bas le docteur!" que: “ Vive le notaire!” Elle cria aussi sa formule favorite: “Que cela vous plaise ou non, vous devrez le supporter!” Elle parcourut ainsi chaque ruelle, chaque sentier, criant et agitant le drapeau, suivie de la foule des vainqueurs qui reprenait ses slogans.
Mais tout a une fin. Le village, au bout de quelques mois, reprit son train-train, redevint ce qu'il était d'habitude, on y travailla, on rendit des services à ses voisins qui en rendirent à leur tour, on y soigna son potager, on ramassa les châtaignes en octobre et on descendit à la plaine en hiver pour les travaux de la vigne. En somme, on fit comme on avait toujours fait.
Un soir, vers la mi-février, Zia Maria-Stella remonta de la vigne bouillante de fièvre. On la mit au lit avec deux édredons. Sa bru veillait sur elle, et les voisines, compatissantes, ne la quittèrent pas. Mais la malade n'avait besoin de rien, elle avait seulement demandé qu'on appelle le docteur, car elle n'avait confiance qu'en lui. (Celui, justement, qui avait perdu les élections, celui qu'elle avait contribué à faire battre, celui contre qui elle s'était déchaînée lors de la fête de la victoire, au chef-lieu de canton, avec son grand drapeau fièrement déployé.)
Le docteur ne tarda pas trop, on ne l'attendit que deux bonnes petites heures. Il fit son examen puis informa le mari et la bru de la malade qu'il s'agissait d'une bronchite et qu'il fallait un traitement aux lauses bouillantes, aux ventouses et aux cataplasmes, sans oublier une petite diète.
La malade voulut savoir ce que le médecin disait…
- “Je dis que vous avez pris froid, ô Zia Mari!
- Alors, qu'est ce qu'il faut faire, ô sgio dottore?
- Des cataplasmes de drapeau, ô Zia Mari! Vous verrez, vous vous sentirez tout de suite mieux!”
-> Retour à la liste des textes